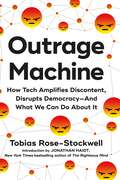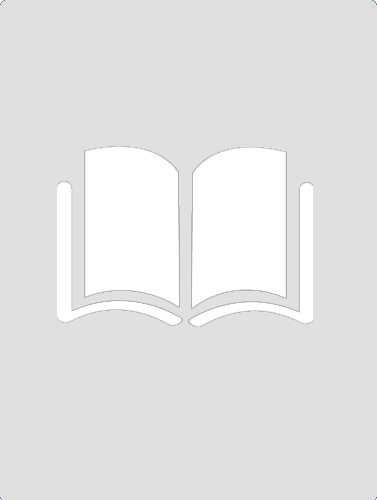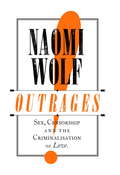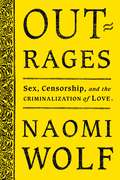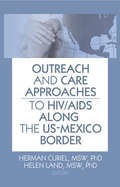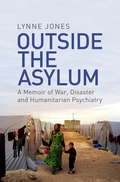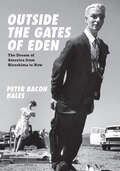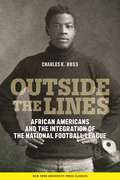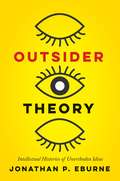- Table View
- List View
Outrage Machine: How Tech Amplifies Discontent, Disrupts Democracy—And What We Can Do About It
by Tobias Rose-StockwellAmazon's Best History Book of the Month for July 2023An invaluable guide to understanding how the internet has broken our brains—and what we can do to fix it. The original internet was not designed to make us upset, distracted, confused, and outraged. But something unexpected happened at the turn of the last decade, when a handful of small features were quietly launched at social media companies with little fanfare. Together, they triggered a cascading set of dramatic changes to how media, politics, and society itself operate—inadvertently creating an Outrage Machine we cannot ignore. Author, designer, and media researcher Tobias Rose-Stockwell shares the defining shifts caused by these technologies, and how they have ignited a society-wide crisis of trust. Drawing from cutting-edge research and vivid personal anecdotes, Rose-Stockwell illustrates how social media has bound us to an unprecedented system of public performance, training us to react rather than reflect, and attack rather than debate.Outrage Machine reveals the triggers and tactics used to exploit our anger, unpacking how these tools hack our deep tribal instincts and psychological vulnerabilities, and how they have become opportunistic platforms for authoritarians and a threat to democratic norms everywhere. But this book is not just about the problem. In a story spanning continents and generations, Rose-Stockwell explores how every new media technology disrupts our ability to make sense of the world, from the printing press to the telegraph, from radio to television. Outrage Machine situates social media within a historical cycle of confusion, violence, and emerging tolerance. Using clear language and powerful illustrations, this book reveals the magnitude of the challenges we face, while offering realistic solutions and a promising pathway out.
Outrage: The Arts and the Creation of Modernity
by Katherine GiuffreA cultural revolution in England, France, and the United States beginning during the time of the industrial and political revolutions helped usher in modernity. This cultural revolution worked alongside the better documented political and economic revolutions to usher in the modern era of continuous revolution. Focusing on the period between 1847 and 1937, the book examines in depth six of the cultural "battles" that were key parts of this revolution: the novels of the Brontë sisters, the paintings of the Impressionists, the poetry of Emily Dickinson, the Ballets Russes production of Le Sacre du printemps, James Joyce's Ulysses, and Zora Neale Hurston's Their Eyes Were Watching God. Using contemporaneous reviews in the press as well as other historical material, we can see that these now-canonical works provoked outrage at the time of their release because they addressed critical points of social upheaval and transformation in ways that engaged broad audiences with subversive messages. This framework allows us to understand and navigate the cultural debates that play such an important role in 21st century politics.
Outrageous Acts and Everyday Rebellions, Second Edition
by Gloria SteinemMost of these essays were originally published in Ms. Magazine in the 1970s and early 1980s. In many cases Steinem has added postscripts to update the material and to describe how the original article was received. The subject matter ranges widely. In one piece Steinem celebrates the life of her mother, who battled mental illness for decades. In "I Was a Playboy Bunny" she describes a week working at the Playboy Club as an undercover reporter. In the section called Five Women Steinem reflects on the lives and legacies of such figures as Jacqueline Kennedy Onassis, Marilyn Monroe, and Linda Lovelace. One piece is an outcry again the horrors of female genital mutilation.
Outrageous Acts and Everyday Rebellions: Second Edition (Owlet Book, An)
by Gloria SteinemThis New York Times bestseller from the legendary feminist featured in the film The Two Glorias is as relevant today as when it was first published. Spanning two decades—from the early sixties to the early eighties—the pieces in Gloria Steinem&’s diverse, stimulating, and often prescient first collection dare to ask how our world might change for the better if we each behaved &“as if everyone mattered.&” An early assignment as a &“girl reporter,&” going undercover as a Bunny in Hugh Hefner&’s Playboy Club, becomes an eye-opening exposé of appalling work conditions and sexual harassment. As Steinem observed, &“I think Hefner himself wants to go down in history as a person of sophistication and glamour. But the last person I would want to go down in history as is Hugh Hefner.&” In addition to &“I Was a Playboy Bunny,&” the essays in this collection challenge the practices and preconceptions that marginalize, exclude, exploit, and victimize women. Steinem understands that the political is always personal, and vice versa, and as such her writings range from the polemical—&“Erotica vs. Pornography&” and &“The Politics of Food&”—to the deeply personal—&“Ruth&’s Song,&” a moving tribute to her mentally ill mother—to sharp satire like &“If Men Could Menstruate.&” One of the first to address topics such as female genital mutilation and transgenderism, Steinem has truly earned the right to be called a feminist pioneer, and this volume is both a testament to her legacy in the fight for equality and an entertaining, thought-provoking journey through the lives of modern women. This ebook features an illustrated biography of Gloria Steinem including rare images from the author&’s personal collection.
Outrages: Sex, Censorship and the Criminalisation of Love
by Naomi WolfThe bestselling author of The Beauty Myth, Vagina and The End of America chronicles the struggles and eventual triumph of John Addington Symonds, a Victorian-era poet, biographer, and critic who penned what became a foundational text on our modern understanding of human sexual orientation and LGBTQ+ legal rights.In Outrages, Naomi Wolf chronicles the struggles and eventual triumph of John Addington Symonds, a Victorian-era poet, biographer, and critic who penned what became a foundational text on our modern understanding of human sexual orientation and LGBTQ+ legal rights, despite writing at a time when anything interpreted as homoerotic could be used as evidence in trials leading to harsh sentences under British law. Wolf's book is extremely relevant today for what it has to say about the vital importance of freedom of speech and the courageous roles of publishers and booksellers in an era of growing calls for censorship and ever-escalating state violations of privacy. At a time when the American Library Association, the Guardian, and other observers document national and global efforts from censoring LGBTQ+ voices in libraries to using anti-trans and homophobic sentiments cynically to win elections, the story of how such hateful efforts evolved from the past, to reach down to us now, is more important than ever. Drawing on the work of a range of scholars of censorship and of LGBTQ+ legal history, Wolf depicts how state censorship, and state prosecution of same-sex sexuality, played out-decades before the infamous trial of Oscar Wilde-shadowing the lives of people who risked in ever-changing, targeted ways scrutiny by the criminal justice system. She shows how legal persecutions of writers, and of men who loved men affected Symonds and his contemporaries, all the while, Walt Whitman's Leaves of Grass was illicitly crossing the Atlantic and finding its way into the hands of readers who reveled in the American poet's celebration of freedom, democracy, and unfettered love. Inspired by Whitman, Symonds kept trying, stubbornly, to find a way to express his message-that love and sex between men were not 'morbid' and deviant, but natural and even ennobling. He wrote a strikingly honest secret memoir written in code to embed hidden messages-which he embargoed for a generation after his death - and wrote the essay A Problem in Modern Ethics that was secretly shared in his lifetime and is now rightfully understood as one of the first gay rights manifestos in the English language. Equal parts insightful historical critique and page-turning literary detective story, Wolf's Outrages is above all an uplifting testament to the triumph of romantic love.
Outrages: Sex, Censorship, and the Criminalization of Love
by Naomi WolfOutrages: Sex, Censorship, and the Criminalization of Love
Outrages: Sex, Censorship, and the Criminalization of Love
by Naomi WolfFrom New York Times bestselling author Naomi Wolf, Outrages explores the history of state-sponsored censorship and violations of personal freedoms through the inspiring, forgotten history of one writer&’s refusal to stay silenced.In 1857, Britain codified a new civil divorce law and passed a severe new obscenity law. An 1861 Act of Parliament streamlined the harsh criminalization of sodomy. These and other laws enshrined modern notions of state censorship and validated state intrusion into people&’s private lives.In 1861, John Addington Symonds, a twenty-one-year-old student at Oxford who already knew he loved and was attracted to men, hastily wrote out a seeming renunciation of the long love poem he&’d written to another young man.Outrages chronicles the struggle and eventual triumph of Symonds—who would become a poet, biographer, and critic—at a time in British history when even private letters that could be interpreted as homoerotic could be used as evidence in trials leading to harsh sentences under British law.Drawing on the work of a range of scholars of censorship and of LGBTQ+ legal history, Wolf depicts how state censorship, and state prosecution of same-sex sexuality, played out—decades before the infamous trial of Oscar Wilde—shadowing the lives of people who risked in new ways scrutiny by the criminal justice system. She shows how legal persecutions of writers, and of men who loved men affected Symonds and his contemporaries, including Christina and Dante Gabriel Rossetti, Algernon Charles Swinburne, Walter Pater, and the painter Simeon Solomon. All the while, Walt Whitman&’s Leaves of Grass was illicitly crossing the Atlantic and finding its way into the hands of readers who reveled in the American poet&’s celebration of freedom, democracy, and unfettered love.Inspired by Whitman, and despite terrible dangers he faced in doing so, Symonds kept trying, stubbornly, to find a way to express his message—that love and sex between men were not &“morbid&” and deviant, but natural and even ennobling.He persisted in various genres his entire life. He wrote a strikingly honest secret memoir—which he embargoed for a generation after his death—enclosing keys to a code that the author had used to embed hidden messages in his published work. He wrote the essay A Problem in Modern Ethics that was secretly shared in his lifetime and would become foundational to our modern understanding of human sexual orientation and of LGBTQ+ legal rights. This essay is now rightfully understood as one of the first gay rights manifestos in the English language.Naomi Wolf&’s Outrages is a critically important book, not just for its role in helping to bring to new audiences the story of an oft-forgotten pioneer of LGBTQ+ rights who could not legally fully tell his own story in his lifetime. It is also critically important for what the book has to say about the vital and often courageous roles of publishers, booksellers, and freedom of speech in an era of growing calls for censorship and ever-escalating state violations of privacy. With Outrages, Wolf brings us the inspiring story of one man&’s refusal to be silenced, and his belief in a future in which everyone would have the freedom to love and to speak without fear.
Outreach and Care Approaches to HIV/AIDS Along the US-Mexico Border
by Herman Curiel Helen LandGet the latest on culturally sensitive health care practices The United States-Mexico border region extends over 2,000 miles, and those residing there struggle to come to grips with several health and poverty challenges. Outreach and Care Approaches to HIV/AIDS Along the US-Mexico Border discusses the various complex factors influencing the control of HIV/AIDS along the US-Mexico Border. The book presents in-depth insights into the problems of language differences, lack of resources, poverty, culture, social stigma, fear of rejection from their communities, and other pressing issues dealing with this devastating health challenge. Practical approaches and strategies are detailed, emphasizing culturally sensitive health care practices.Outreach and Care Approaches to HIV/AIDS Along the US-Mexico Border reveals the latest research and assessment of services currently taking place in various states along this region. Innovative outreach strategies are described, along with accompanying studies detailing the program&’s success in targeting a specific issue. The book is extensively referenced and includes numerous tables and figures to clarify ideas and quantify data. Topics in Outreach and Care Approaches to HIV/AIDS Along the US-Mexico Border include: Health Resources and Services Administration&’s efforts of its HIV/AIDS Bureau (HAB) practical expanded HIV counseling and testing a study on personal lifestyles and demographics of 1200 HIV seropositive individuals current research on health access issues the New Mexico Border Health Initiative (NMBHI) use of peer outreach-with programmatic elements, implications for practice, and recommendations for program coordinators the implementation and evaluation of an AIDS Education and Training Center (AETC) physician training program examination of an effective pilot HIV prevention intervention targeting Mexican/Latino migrant day laborers counseling intervention for female sex workers Transcultural Case Management (TCM) intervention program and its resultsOutreach and Care Approaches to HIV/AIDS Along the US-Mexico Border shines a crucial spotlight on the neglected problem of HIV and AIDS along border areas. The book is an important addition to the literature for social workers, health care professionals, and anyone involved with providing effective social, educational, and clinical services to all individuals affected by HIV/AIDS.
Outside Justice: Immigration and the Criminalizing Impact of Changing Policy and Practice
by David C Brotherton Shirley P Leyro Daniel L StagemanOutside Justice: Undocumented Immigrants and the Criminal Justice System fills a clear gap in the scholarly literature on the increasing conceptual overlap between popular perceptions of immigration and criminality, and its reflection in the increasing practical overlap between criminal justice and immigration control systems. Drawing on data from the United States and other nations, scholars from a range of academic disciplines examine the impact of these trends on the institutions, communities, and individuals that are experiencing them. Individual entries address criminal victimization and labor exploitation of undocumented immigrant communities, the effects of parental detention and deportation on children remaining in destination countries, relations between immigrant communities and law enforcement agencies, and the responses of law enforcement agencies to drastic changes in immigration policy, among other topics. Taken as a whole, these essays chart the ongoing progression of social forces that will determine the well-being of Western democracies throughout the 21st century. In doing so, they set forth a research agenda for reexamining and challenging the goals of converging criminal justice and immigration control policy, and raise a number of carefully considered, ethical alternatives to the contemporary policy status quo. Contemporary immigration is the focus of highly charged rhetoric and policy innovation, both attempting to define the movement of people across national borders as fundamentally an issue of criminal justice. This realignment has had profound effects on criminal justice policy and practice and immigration control alike, and raises far-reaching implications for social inclusion, labor economies, community cohesion, and a host of other areas of immediate interest to social science researchers and practitioners.
Outside and Inside: Race and Identity in White Jazz Autobiography (American Made Music Series)
by Reva MarinOutside and Inside: Representations of Race and Identity in White Jazz Autobiography is the first full-length study of key autobiographies of white jazz musicians. White musicians from a wide range of musical, social, and economic backgrounds looked to black music and culture as the model on which to form their personal identities and their identities as professional musicians. Their accounts illustrate the triumphs and failures of jazz interracialism. As they describe their relationships with black musicians who are their teachers and peers, white jazz autobiographers display the contradictory attitudes of reverence and entitlement, and deference and insensitivity that remain part of the white response to black culture to the present day. Outside and Inside features insights into the development of jazz styles and culture in the urban meccas of twentieth-century jazz in New Orleans, Chicago, New York, and Los Angeles. Reva Marin considers the autobiographies of sixteen white male jazz instrumentalists, including renowned swing-era bandleaders Benny Goodman, Artie Shaw, and Charlie Barnet; reed instrumentalists Mezz Mezzrow, Bob Wilber, and Bud Freeman; trumpeters Max Kaminsky and Wingy Manone; guitarist Steve Jordan; pianists Art Hodes and Don Asher; saxophonist Art Pepper; guitarist and bandleader Eddie Condon; and New Orleans–style clarinetist Tom Sancton. While critical race theory informs this work, Marin argues that viewing these texts simply through the lens of white privilege does not do justice to the kind of sustained relationships with black music and culture described in the accounts of white jazz autobiographers. She both insists upon the value of insider perspectives and holds the texts to rigorous scrutiny, while embracing an expansive interpretation of white involvement in black culture. Marin opens new paths for study of race relations and racial, ethnic, and gender identity formation in jazz studies.
Outside the Asylum: A Memoir of War, Disaster and Humanitarian Psychiatry
by Lynne Jones'A profound memoir' Daily Telegraph'As revealing as the writing of Oliver Sacks' Mark CousinsOutside the Asylum is Lynne Jones's personal and highly acclaimed exploration of humanitarian psychiatry and the changing world of international relief. Her memoir graphically describes her experiences in war zones and disasters around the world, from the Balkans and 'mission-accomplished' Iraq, to tsunami-affected Indonesia, post-earthquake Haiti and 'the Jungle' in Calais.
Outside the Asylum: A Memoir of War, Disaster and Humanitarian Psychiatry
by Lynne JonesWhat happens if the psychiatric hospital in which you have lived for ten years is bombed and all the staff run away? What is it like to be a twelve-year-old and see all your family killed in front of you? Is it true that almost everyone caught up in a disaster is likely to suffer from post-traumatic stress disorder? What can mental health professionals do to help? How does one stay neutral and impartial in the face of genocide? Why would a doctor support military intervention?Outside the Asylum is Lynne Jones's personal exploration of of humanitarian psychiatry and the changing world of international relief; a memoir of more than twenty-five years as a practising psychiatrist in war and disaster zones around the world. From her training in one of Britain's last asylums, to treating traumatised soldiers in Gorazde after the Bosnian war, helping families who lost everything in the earthquake in Haiti, and learning from traditional healers in Sierra Leone, Lynne has worked with extraordinary people in extraordinary situations. This is a book that shines a light on the world of humanitarian aid, and that shows us the courage and resilience of the people who have to live, work and love in some of the most frightening situations in the world.
Outside the Box: A Statistical Journey through the History of Football
by Duncan AlexanderIn football, numbers are everywhere. From touches in the opposition box to expected goals, clear-cut chances to win-loss ratios. In the modern game, these numbers help provide the narrative, the drama, and the conversation. They are scrutinised in order to justify results and to predict future outcomes. They even dictate transfer policy and drive clubs to achieve the impossible.But when did the numbers become so important and what do they mean?In Outside the Box, Duncan Alexander looks back at twenty-five years of the Premier League and beyond, uncovering the hidden truths and accepted myths that surround the game. Using the archives of OptaJoe and never-before-seen data, we discover why Liverpool have gone 27 years without winning a league title and why Lionel Messi is the best player in the game’s history. Or is he? Insightful, wry, and hugely entertaining, Outside the Box is an enlightening and accessible account of football across the decades, analysing data from the some of the greatest seasons, players, teams and managers.
Outside the Fold: Conversion, Modernity, and Belief
by Gauri ViswanathanOutside the Fold is a radical reexamination of religious conversion. Gauri Viswanathan skillfully argues that conversion is an interpretive act that belongs in the realm of cultural criticism. To that end, this work examines key moments in colonial and postcolonial history to show how conversion questions the limitations of secular ideologies, particularly the discourse of rights central to both the British empire and the British nation-state. Implicit in such questioning is an attempt to construct an alternative epistemological and ethical foundation of national community. Viswanathan grounds her study in an examination of two simultaneous and, she asserts, linked events: the legal emancipation of religious minorities in England and the acculturation of colonial subjects to British rule. The author views these two apparently disparate events as part of a common pattern of national consolidation that produced the English state. She seeks to explain why resistance, in both cases, frequently took the form of religious conversion, especially to "minority" or alternative religions. Confronting the general characterization of conversion as assimilative and annihilating of identity, Viswanathan demonstrates that a willful change of religion can be seen instead as an act of opposition. Outside the Fold concludes that, as a form of cultural crossing, conversion comes to represent a vital release into difference.Through the figure of the convert, Viswanathan addresses the vexing question of the role of belief and minority discourse in modern society. She establishes new points of contact between the convert as religious dissenter and as colonial subject. This convergence provides a transcultural perspective not otherwise visible in literary and historical texts. It allows for radically new readings of significant figures as diverse as John Henry Newman, Pandita Ramabai, Annie Besant, and B. R. Ambedkar, as well as close studies of court cases, census reports, and popular English fiction. These varying texts illuminate the means by which discourses of religious identity are produced, contained, or opposed by the languages of law, reason, and classificatory knowledge. Outside the Fold is a challenging, provocative contribution to the multidisciplinary field of cultural studies.
Outside the Gates of Eden: The Dream of America from Hiroshima to Now
by Peter Bacon HalesThe cultural historian and author of Atomic Spaces offers a comprehensive account of the Baby Boomer years—from the atomic age to the virtual age. Born under the shadow of the atomic bomb, with little security but the cold comfort of duck-and-cover drills, the postwar generations lived through—and led—some of the most momentous changes in all of American history. In this new cultural history, Peter Bacon Hales explores those decades through a succession of resonant moments, spaces, and artifacts of everyday life. Finding unexpected connections, he traces the intertwined undercurrents of promise and peril. From newsreels of the first atomic bomb tests to the invention of a new ideal American life in Levittown; from the teen pop music of the Brill Building and the Beach Boys to Bob Dylan&’s canny transformations; from the painful failures of communes to the breathtaking utopian potential of the digital age, Hales reveals a nation in transition as a new generation began to make its mark on the world it was inheriting. Outside the Gates of Eden is the most comprehensive account yet of the baby boomers, their parents, and their children, as seen through the places they built, the music and movies and shows they loved, and the battles they fought to define their nation, their culture, and their place in what remains a fragile and dangerous world.
Outside the Lines: African Americans and the Integration of the National Football League
by Charles K. RossExplores the often overlooked role of the NFL in the American civil rights movementWatching a football game on a Sunday evening, most sports fans do not realize the profound impact the National Football League had on the civil rights movement. Similarly, in a sport where seven out of ten players are Black, few are fully aware of the history and contributions of their athletic forebears. Among the touchdowns and tackles lies a rich history of African American life and the struggle to achieve equal rights.Outside the Lines traces how football laid a foundation for social change long before the judicial system formally recognized the inequalities of racial separation. Integrating teams to include white and Black athletes alike fifty years before the reversal of Plessy v Ferguson, the National Football League served as a microcosmic fishbowl of the highs and lows—the trials and triumphs—of racial integration. In this chronicle of the important stories of Black NFL athletes in the early twentieth century, Charles K. Ross has given us an important insight into the role of sports in the fight for racial justice.
Outside the Lines: Talking with Contemporary Gay Poets
by Christopher Hennessy"Outside the Lines explores the personal and historical forces that have shaped the work of a dozen gifted poets. The answers given to Hennessy's astute, perfectly tailored questions remind a reader how exciting poetry can be, and how writers create, through language, the world as we have never known it. These adventuresome interviews will stir anyone who cares about the making of art." ---Bernard Cooper, author of Maps to Anywhere. Editor Christopher Hennessy gathers interviews with some of the most significant figures in contemporary American poetry. While each poet is gay, these encompassing, craft-centered interviews reflect the diversity of their respective arts and serve as a testament to the impact gay poets have had and will continue to have on contemporary poetics. The book includes twelve frank, intense interviews with some of America's best-known and loved poets, who have not only enjoyed wide critical acclaim but who have had lasting impact on both the gay tradition and the contemporary canon writ large, for example, Frank Bidart, the late Thom Gunn, and J. D. McClatchy. Some of the most honored and respected poets, still in the middle of their careers, are also included, for example, Mark Doty, Carl Phillips, and Reginald Shepherd. Each interview explores the poet's complete work to date, often illuminating the poet's technical evolution and emotional growth, probing shifts in theme, and even investigating links between verse and sexuality. In addition to a selected bibliography of works by established poets, the book also includes a list of works by newer and emerging poets who are well on their way to becoming important voices of the new millennium.
Outside the Paint: When Basketball Ruled at the Chinese Playground
by Kathleen S. YepThis fascinating book reveals that Chinese Americans began "shooting hoops" nearly a century before Chinese superstar Yao Ming turned pro. Drawing on interviews with players and coaches, Outside the Paint takes readers back to San Francisco in the 1930s and 1940s, when young Chinese American men and women developed a new approach to the game--with fast breaks, intricate passing and aggressive defense--that was ahead of its time. Every chapter tells a surprising story: the Chinese Playground, the only public outdoor space in Chinatown; the Hong Wah Kues, a professional barnstorming men's basketball team; the Mei Wahs, a championship women's amateur team; Woo Wong, the first Chinese athlete to play in Madison Square Garden; and the extraordinarily talented Helen Wong, whom Kathleen Yep compares to Babe Didrikson. Outside the Paintchronicles the efforts of these highly accomplished athletes who developed a unique playing style that capitalized on their physical attributes, challenged the prevailing racial hierarchy, and enabled them, for a time, to leave the confines of their segregated world. They learned to dribble, shoot, and steal.
Outsider Citizens: The Remaking of Postwar Identity in Wright, Beauvoir, and Baldwin (Literary Criticism and Cultural Theory)
by Sarah RelyeaOutsider Citizens examines a foundational moment in the writing of race, gender, and sexuality––the decade after 1945, when Richard Wright, Simone de Beauvoir, and others sought to adapt existentialism and psychoanalysis to the representation of newly emerging public identities. Relyea offers the first book-length study bringing together Wright and Beauvoir to reveal their common sources and concerns. Relyea's discussion begins with Native Son and then examines Wright's postwar exile in France and his engagement with existentialism and psychoanalysis in The Outsider. Beauvoir met Wright during her postwar tour of America, chronicled in America Day by Day. After returning to France, Beauvoir adapted American social constructionist concepts of race as one source for her philosophical investigation of gender in The Second Sex, while also rejecting 1940s psychoanalytic theories of femininity. Relyea examines later representations of race and gender in a discussion of James Baldwin's critique of postwar American liberalism and ideals of innocence and masculinity in Giovanni's Room, which represents the remaking of white American identity through the risks of exile and the return of the gaze.
Outsider Theory: Intellectual Histories of Unorthodox Ideas
by Jonathan EburneA vital and timely reminder that modern life owes as much to outlandish thinking as to dominant ideologies What do the Nag Hammadi library, Dan Brown&’s The Da Vinci Code, speculative feminist historiography, Marcus Garvey&’s finances, and maps drawn by asylum patients have in common? Jonathan P. Eburne explores this question as never before in Outsider Theory, a timely book about outlandish ideas. Eburne brings readers on an adventure in intellectual history that stresses the urgency of taking seriously—especially in an era of fake news—ideas that might otherwise be discarded or regarded as errant, unfashionable, or even unreasonable. Examining the role of such thinking in contemporary intellectual history, Eburne challenges the categorical demarcation of good ideas from flawed, wild, or bad ones, addressing the surprising extent to which speculative inquiry extends beyond the work of professional intellectuals to include that of nonprofessionals as well, whether amateurs, unfashionable observers, or the clinically insane. Considering the work of a variety of such figures—from popular occult writers and gnostics to so-called outsider artists and pseudoscientists—Eburne argues that an understanding of its circulation and recirculation is indispensable to the history of ideas. He devotes close attention to ideas and texts usually omitted from or marginalized within orthodox histories of literary modernism, critical theory, and continental philosophy, yet which have long garnered the critical attention of specialists in religion, science studies, critical race theory, and the history of the occult. In doing so he not only sheds new light on a fascinating body of creative thought but also proposes new approaches for situating contemporary humanities scholarship within the history of ideas. However important it might be to protect ourselves from &“bad&” ideas, Outsider Theory shows how crucial it is for us to know how and why such ideas have left their impression on modern-day thinking and continue to shape its evolution.
Outsider in the Promised Land: An Iraqi Jew in Israel
by Nissim RejwanIn 1951, Israel was a young nation surrounded by hostile neighbors. Its tenuous grip on nationhood was made slipperier still by internal tensions among the various communities that had immigrated to the new Jewish state, particularly those between the politically and socially dominant Jewish leadership hailing from Eastern Europe and the more numerous Oriental Jews from the Middle East and North Africa. Into this volatile mix came Nissim Rejwan, a young Iraqi Jewish intellectual who was to become one of the country's leading public intellectuals and authors. Beginning with Rejwan's arrival in 1951 and climaxing with the tensions preceding Israel's victory in the Six-Day War of 1967, this book colorfully chronicles Israel's internal and external struggles to become a nation, as well as the author's integration into a complex culture. Rejwan documents how the powerful East European leadership, acting as advocates of Western norms and ideals, failed to integrate Israel into the region and let the country take its place as a part of the Middle East. Rejwan's essays and occasional articles are an illuminating example of how minority groups use journalism to gain influence in a society. Finally, the letters and diary entries reproduced in Outsider in the Promised Land are full of lively, witty meditations on history, literature, philosophy, education, and art, as well as one man's personal struggle to find his place in a new nation.
Outsiders Inside: Whiteness, Place and Irish Women (Gender, Racism, Ethnicity Ser.)
by Bronwen WalterNotions of diaspora are central to contemporary debates about 'race', ethnicity, identity and nationalism. Yet the Irish diaspora, one of the oldest and largest, is often excluded on the grounds of 'whiteness'. Outsiders Inside explores the themes of displacement and the meanings of home for these women and their descendants. Juxtaposing the visibility of Irish women in the United States with their marginalization in Britain, Bronwen Walter challenges linear notions of migration and assimilation by demonstrating that two forms of identification can be held simultaneously. In an age when the Northern Ireland peace process is rapidly changing global perceptions of Irishness, Outsiders Inside moves the empirical study of the Irish diaspora out of the 'ghetto' of Irish Studies and into the mainstream, challenging theorists and policy-makers to pay attention to the issue of white diversity.
Outsiders Still
by Vivian SmithDespite years of dominating journalism school classrooms across North America, women remain vastly underrepresented at the highest levels of newspaper leadership. Why do so many female journalists leave the industry and so few reach the top?Interviewing female journalists at daily newspapers across Canada, Vivian Smith - who spent fourteen years at The Globe and Mail as a reporter, editor, and manager - finds that many of the obstacles that women face in the newspaper industry are the same now as they have been historically, made worse by the challenging times in which the industry finds itself. The youngest fear they will have to choose between a career and a family; mid-career women madly juggle the pressures of work and family while worrying that they are not "good mothers"; and the most senior reflect on decades of accomplishments mixed with frustration at newsroom sexism that has held them back.Listening carefully to the stories these journalists tell, both about themselves and about what they write, Smith reveals in Outsiders Still how overt hostility to women in the newsroom has been replaced by systemic inequality that limits or ends the careers of many female journalists. Despite decades of contributions to society's news agenda, women print journalists are outsiders still.
Outsiders Together: Virginia and Leonard Woolf
by Natania RosenfeldThe marriage of Virginia and Leonard Woolf is best understood as a dialogue of two outsiders about ideas of social and political belonging and exclusion. These ideas infused the written work of both partners and carried over into literary modernism itself, in part through the influence of the Woolfs' groundbreaking publishing company, the Hogarth Press. In this book, the first to focus on Virginia Woolf's writings in conjunction with those of her husband, Natania Rosenfeld illuminates Leonard's sense of ambivalent social identity and its affinities to Virginia's complex ideas of subjectivity. At the time of the Woolfs' marriage, Leonard was a penniless ex-colonial administrator, a fervent anti-imperialist, a committed socialist, a budding novelist, and an assimilated Jew who vacillated between fierce pride in his ethnicity and repudiation of it. Virginia was an "intellectual aristocrat," socially privileged by her class and family background but hobbled through gender. Leonard helped Virginia elucidate her own prejudices and elitism, and his political engagements intensified her identification with outsiders in British society. Rosenfeld discovers an aesthetic of intersubjectivity constantly at work in Virginia Woolf's prose, links this aesthetic to the intermeshed literary lives of the Woolfs, and connects both these sites of dialogue to the larger sociopolitical debates--about imperialism, capitalism, women, sexuality, international relations, and, finally, fascism--of their historical place and time.
Outsiders Within: Writing on Transracial Adoption
by Jane Jeong Trenka Sun Yung Shin Julia Chinyere OparahConfronting trauma behind the transnational adoption system—now back in printMany adoptees are required to become people that they were never meant to be. While transracial adoption tends to be considered benevolent, it often exacts a heavy emotional, cultural, and economic toll on those who directly experience it. Outsiders Within is a landmark publication that carefully explores this most intimate aspect of globalization through essays, fiction, poetry, and art. Moving beyond personal narrative, transracially adopted writers from around the world tackle difficult questions about how to survive the racist and ethnocentric worlds they inhabit, what connects the countries relinquishing their children to the countries importing them, why poor families of color have their children removed rather than supported—about who, ultimately, they are. In their inquiry, the contributors unseat conventional understandings of adoption politics, reframing the controversy as a debate that encompasses human rights, peace, and reproductive justice. Contributors: Heidi Lynn Adelsman; Ellen M. Barry; Laura Briggs, U of Massachusetts, Amherst; Catherine Ceniza Choy, U of California, Berkeley; Gregory Paul Choy, U of California, Berkeley; Rachel Quy Collier; J. A. Dare; Kim Diehl; Kimberly R. Fardy; Laura Gannarelli; Shannon Gibney; Mark Hagland; Perlita Harris; Tobias Hübinette, Stockholm U; Jae Ran Kim; Anh Đào Kolbe; Mihee-Nathalie Lemoine; Beth Kyong Lo; Ron M.; Patrick McDermott, Salem State College, Massachusetts; Tracey Moffatt; Ami Inja Nafzger (aka Jin Inja); Kim Park Nelson; John Raible; Dorothy Roberts, Northwestern U; Raquel Evita Saraswati; Kirsten Hoo-Mi Sloth; Soo Na; Shandra Spears; Heidi Kiiwetinepinesiik Stark; Kekek Jason Todd Stark; Sunny Jo; Sandra White Hawk; Indigo Williams Willing; Bryan Thao Worra; Jeni C. Wright.